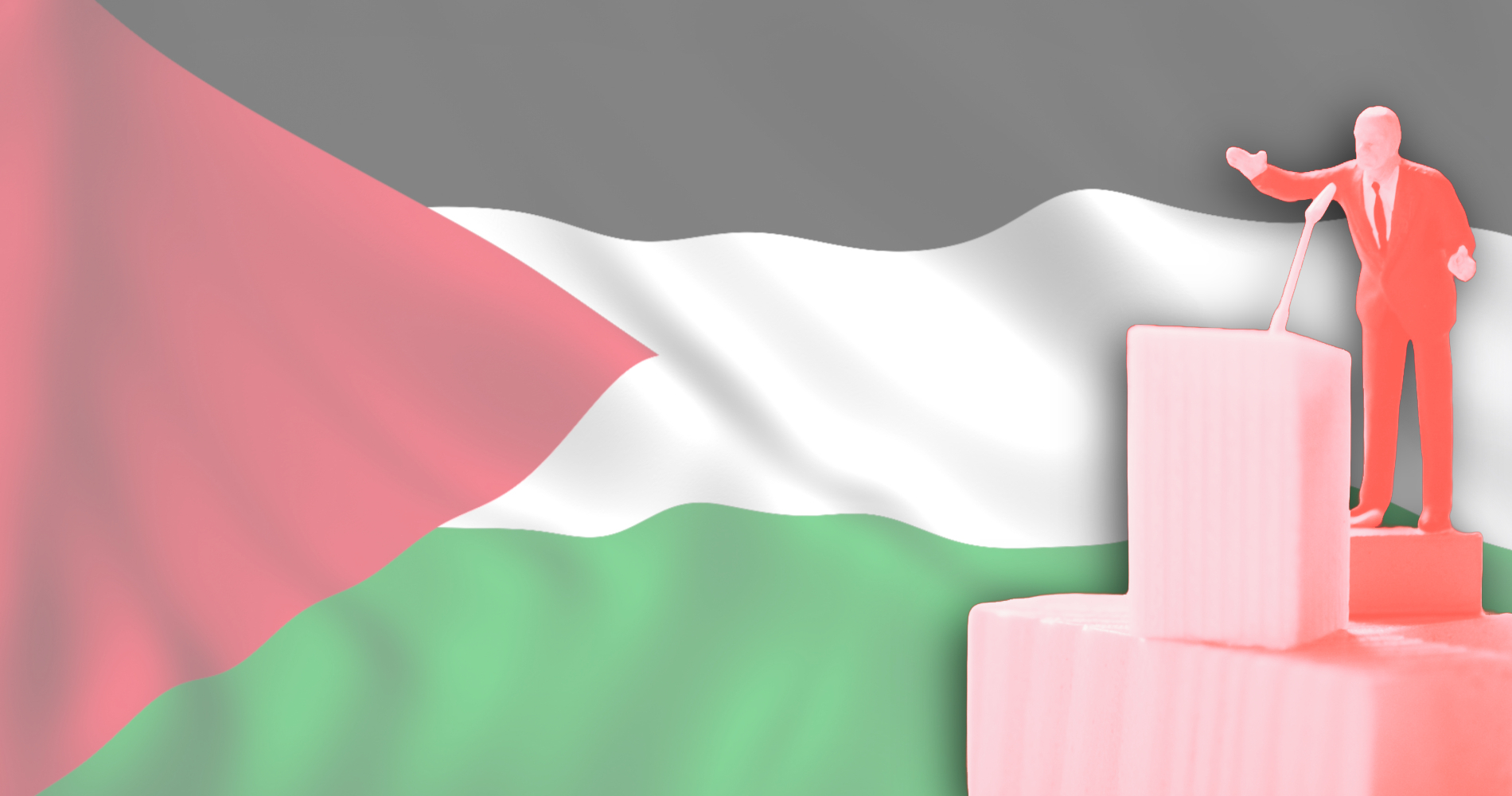Alors que présentement dix mille espèces de virus risqueraient d’infecter les humains, la plupart d’entre eux circulent en silence parmi les animaux sauvages. À l’instar d’Ebola ou du SARS-CoV-2, des cas de débordement zoonotique, dit autrement des transmissions de virus de l’animal à l’humain, se produisent parfois. Un constat qui est d’autant plus vrai sachant que les animaux porteurs de ces virus tendent de se rapprocher des espaces habités par les humains à cause, entre autres, de la destruction des milieux naturels, de la réduction des territoires habités par ces animaux et du réchauffement climatique. Force est de constater que ces mutations risque d’accélérer la naissance de maladies infectieuses dans le monde.
Tandis que de telles situations pourraient se produire dans l’avenir, la pandémie de la COVID-19 nous a révélé que les licences obligatoires, bien qu’elles soient nécessaires pour atténuer les obstacles nuisant à l’accès aux médicaments, leur utilisation pose plusieurs problèmes dans l’hémisphère Sud. Un tel constat est d’autant plus vrai alors que la proposition alternative des anti-dérogations a été insuffisante pour atténuer les écarts de vaccination entre le Nord et le Sud. Non seulement elle a été insuffisante pour endiguer une pandémie aussi globale que celle de la COVID-19, mais elle a été inadéquate pour assurer un accès juste aux vaccins contre la COVID-19.
À l’origine des licences obligatoires
Entre 1986 et 1994, les négociations ayant été menées sous l’égide du Cycle d’Uruguay ont abouti à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC). Bien que son but ultime soit d’assurer la protection de la propriété intellectuelle, il prévoit des mesures exceptionnelles pour s’attaquer aux risques nuisant à la santé publique.
Bien que de telles exceptions soient acceptées, leurs significations demeurent polysémiques, à l’image des licences obligatoires qui incorporent autant de questionnements entre autres, de quelles manières seraient-elles interprétées et dans quelle mesure leur usage serait admis ?
Tel que discuté par les ministres des membres lors de la conférence ministérielle de Doha, chaque membre a le droit de spécifier les raisons pour lesquelles ces licences sont accordées. A priori, parce que la propriété intellectuelle n’est pas supposée nuire au droit à la santé, qu’il est permis d’utiliser les licences obligatoires pour déroger aux obligations en question. Provisoirement, les membres utilisateurs ont le droit d’autoriser la concurrence générique, et de suspendre le monopole d’exploitation associé aux brevets sur un médicament donné. Il leur est ainsi possible de distribuer des génériques abordables sur une durée déterminée, sans pour autant craindre de violer les obligations que leur impose l’accord sur les ADPIC.
Un recours rare, une réalité à nuancer
Bien que les licences obligatoires soient juridiquement permises par l’accord sur les ADPIC, leur usage par les pays en développement n’est pas synonyme d’accès aux médicaments. Nombreuses sont les difficultés à surmonter pour un membre qui entend légitimement se servir de cet outil.
Tandis que les arguments pour ou contre les licences obligatoires fleurissent ici et là, il appert essentiel de rappeler que le recours à celles-ci est épisodique au Sud, notamment, en raison des pressions internationales et de procédures fastidieuses et laborieuses. Un tel constat est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’étudier leur occurrence dans le monde. Entre 1995 et 2011, 24 licences obligatoires ont été annoncées selon Beall et Kuhn (2012), dont 6 annonces entre 1995 et 2002, 11 entre 2003 et 2005 et 7 entre 2006 et 2011. Si les deux tiers de ces annonces concernent des antirétroviraux, soit, 16 annonces sur 24, 13 annonces au total ont été appliquées par des économies à revenu intermédiaire supérieur. Clairement, sachant que le recours aux licences obligatoires demeure malgré tout faible, il s’avère que seules ces dernières y ont vraiment recours.
Premièrement, se cache dernière ces chiffres la pression qu’exercent les pays développés, en particulier, les États-Unis qui sont les premiers à rejeter l’usage des licences obligatoires. Pour dissuader les pays dont les lois sur la propriété intellectuelle sont jugées insuffisantes, les États-Unis leur appliquent des sanctions telles qu’annoncées dans le rapport Special 301. Ce rapport est publié annuellement par le bureau du représentant américain au commerce, en l’occurrence, pour identifier et punir les pays n’offrant pas une protection adéquate. Ainsi, la Thaïlande, qui a annoncé recourir aux licences obligatoires contre le VIH/Sida, a été à plusieurs reprises surveillée en priorité par les autorités américaines sous Special 301. Elle a même été menacée de sanctions commerciales si elle ne reconsidérait pas sa position, bien que les entreprises américaines n’aient pas donné suite à ces appels à discussions.
S’ajoute à cette pression la nature laborieuse des procédures des licences obligatoires. À l’image des licences obligatoires, tel qu’annoncé pour la première fois par le Canada, le recours à celles destinées à l’exportation n’est pas une pratique courante. En 2003, le Canada a été le premier membre à appliquer la décision du conseil général de l’OMC, selon laquelle, l’exportation de médicaments sous licence obligatoire est désormais permise. Il a fallu une année pour adopter la loi de l’engagement de J. Chrétien envers l’Afrique. Bien que la première commande des antirétroviraux soit passée plus tard en 2004, le Rwanda n’a réussi à recevoir son premier lot produit sous licence obligatoire qu’en 2008. Apotex, l’entreprise canadienne chargée de la production et la distribution de l’Apo-TriAvir, a décidé de ne plus renouveler son engagement en vertu du régime d’accès aux médicaments.
Non seulement les procédures à accomplir en la matière sont aussi coûteuses que longues, mais plusieurs obstacles ont rendu le recours aux licences obligatoires impraticable. Seuls les pays en développement enregistrés sur la liste du régime d’accès aux médicaments sont admissibles aux licences obligatoires destinées à l’exportation du Canada. Pire encore, la loi canadienne s’applique uniquement aux médicaments reconnus par le régime canadien. Or, l’OMC qui a initialement permis les licences obligatoires destinées à l’exportation en 2003, n’a en aucun cas limité la décision du conseil général à certains médicaments en particulier. Bien qu’il soit possible d’additionner un générique au régime d’accès aux médicaments, il s’agit d’un délai supplémentaire qui risque de rallonger davantage la procédure.
En outre, avant que tout génériqueur puisse soumettre sa demande de sa licence obligatoire, il doit préalablement tenter d’obtenir une licence volontaire auprès du détenteur du brevet. Sachant que la loi canadienne n’impose aucune durée maximale à ces négociations, les discussions entre le détenteur et le génériqueur pourraient miner la procédure en entier. Sans oublier que les engagements que doit honorer le génériqueur sont très lourds. Entre autres, ce dernier doit non seulement garantir que ses génériques soient exportés vers la destination attendue, mais il lui incombe aussi de s’assurer qu’ils ne soient pas distribués via les circuits illicites. Pour y arriver, il doit préciser clairement la quantité des génériques à produire et à vendre, et de quelles manières ces génériques seraient assurément livrés grâce à un emballage adapté. Toutefois, si la quantité en question est amenée à augmenter au-delà de sa valeur initiale, le génériqueur est obligé de relancer une nouvelle procédure de licence obligatoire, y compris, ses discussions préalables avec le détenteur du brevet pour se procurer une licence volontaire. Au final, 4 millions de dollars est la somme qu’a dû perdre l’entreprise canadienne Apotex dans ces tractations.
Il semble que ce n’est pas la licence obligatoire en soi qui est problématique, mais plutôt, les conditions de son usage comme en attestent les cas canadien et thaïlandais.
Juridiquement, la licence obligatoire est insuffisante
Manifestement, la mise en pratique des licences obligatoires est loin d’être une panacée. Appliquée essentiellement au cas par cas, médicament par médicament et pays par pays, une telle solution, si louable soit-elle, est impropre à la réalité que nous impose la pandémie.
N’ayant pas été conçues à l’origine pour endiguer une pandémie aussi globale que celle-ci, les licences obligatoires entraveraient la coordination juridique entre les membres de l’OMC.
Un tel constat est d’autant plus vrai alors que les licences obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des aspects liés aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre la COVID-19, parmi lesquels, les brevets et les secrets commerciaux. Il y aura autant de licences que de brevets et de secrets incorporés dans ces vaccins. Chacun de ces brevets et de ces secrets commerciaux nécessite sa propre licence. Si les brevets permettent la protection de la technologie derrière la création de ces vaccins, les secrets commerciaux s’appliquent au savoir-faire entre autres les méthodes de production.
Au lieu de se limiter au débat sur les arguments pour ou contre les licences obligatoires, il appert indispensable de questionner le lien entre l’accessibilité et les licences obligatoires, entre autres, l’abordabilité, la disponibilité et la qualité des médicaments, y compris, les vaccins contre la COVID-19.